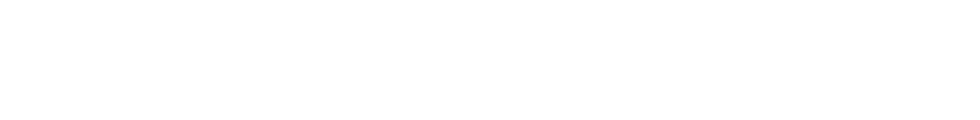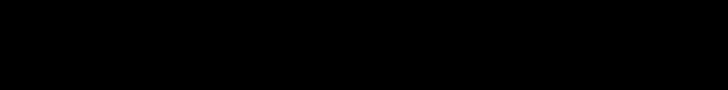Sûrement, la compagnie Dyptik dirigée par le chorégraphe Souhail Marchiche et installée à Saint-Étienne s’impose en imprimant une certaine audace stylistique. La nouvelle chorégraphie, « En quête », présentée au Centre Culturel de la Ricamarie, s’est façonnée au rythme des rencontres, des témoignages, des propos recueillis auprès d’anonymes de différentes générations. Rencontre avec Souhail Marchiche et Mehdi Meghari, co-directeur artistique de la Compagnie :
La compagnie Dyptik fait suite au collectif Melting Force : pouvez-vous nous retracer rapidement votre histoire respective et personnelle ?
Le collectif Melting Force était à la base composé d’un groupe d’amis qui se sont rencontrés à la fin des années 90. Nous avons tous débuté ensemble et c’est ainsi qu’est né le collectif Melting Force. C’est à ce moment-là que nous nous sommes rencontrés tous les deux. C’est bien à travers collectif Melting Force que nous nous sommes formés, que nous avons rencontré d’autres danseurs et que nous avons pu évoluer dans notre pratique de la danse. De fil en aiguille, d’années en années, notre pratique a évolué, notre danse a évolué, notre façon de travailler également… En 2013, nous avons donc décidé de créer la compagnie Dyptik pour sortir de la dynamique du collectif et pouvoir donner une ligne artistique qui nous ressemblait plus. Nous gérions le collectif Melting Force en tant que directeurs artistiques depuis 2007, mais on était en fait plutôt les porte-parole d’un collectif que vraiment les directeurs artistiques. L’idée d’aller vers la création d’une compagnie, Dyptik, répondait à notre volonté de créer une compagnie de danse dans laquelle nous assurerions la direction artistique, une ligne artistique que nous pourrions dessiner et suivre pleinement.
À la fin de l’année 2012, vous rencontrez la compagnie Malienne Dogmen G. Quelle est cette compagnie ?
Fin 2012, nous sommes allés en effet au Mali pour rencontrer la compagnie Dogmen G, une compagnie de danse Hip-Hop basée à Bamako.
Nous étions curieux de découvrir leur travail et leur parcours. Nous avions également de nombreux points communs : le même nombre de créations à notre actif, ils étaient également dans une démarche « autobiographique ». De notre côté, nous étions en pleine interrogation sur la création d’une nouvelle compagnie pour pouvoir créer des pièces dans un cadre plus professionnel. Nous rencontrons donc ces 5 danseurs, motivés mais avec une approche de la danse Hip-Hop très différente de la nôtre. Les Dogmen G sont moins spécialistes sur un domaine, moins techniques, mais ils sont plus vastes dans leurs pratiques et ils enrichissent souvent leur hip-hop de danses Africaines, ce qui crée une certaine originalité chez eux. On a pu découvrir qu’ils étaient très ouverts sur le monde de la danse en général. Ils n’étaient pas forcément juste hip-hop et c’est ce qui nous a vraiment intéressé chez eux et nous a donné envie de travailler avec eux sur la pièce sur laquelle nous étions en train de réfléchir, « Dyptik ». Dans cette pièce, nous voulions parler d’identité. C’était intéressant car ils arrivaient justement avec une identité artistique forte.
Comment s’est produite cette rencontre ?
La rencontre a été initiée par Marion Bargès, anciennement journaliste d’une télé locale à Saint-Étienne. Elle avait fait ses premiers reportages sur le collectif Melting Force. Nous avions beaucoup échangé avec elle quand elle nous avait interviewé sur notre travail. Par la suite elle a travaillé à l’Institut français de Bamako, elle a ainsi pu suivre, rencontrer et aider la compagnie Dogmen G. C’est elle qui a eu l’idée de nous mettre en contact, elle nous a envoyé des vidéos, etc. On a apprécié ces premiers échanges, on a pris notre courage à deux mains et en décembre 2012 on est allé pour la première fois à Bamako les rencontrer.
En France, la danse est très rapidement cataloguée, alors qu’en Afrique, elle apparaît plus globale ou totale. Pourquoi a-t-on ce besoin en France de systématiquement classifier tout et tout le monde ?
C’est le système français qui veut ça… Pas seulement dans la danse mais dans toutes les disciplines en général. On cherche toujours la perfection, le meilleur, le « top du top »… Quand on veut être le meilleur dans quelque chose, il faut choisir une voie et y aller à fond… l’explorer à fond… C’est difficile d’être le meilleur dans cinq domaines en même temps, c’est compliqué, ça demande de beaucoup se perfectionner sur un domaine particulier. On dit cela de la danse mais on peut le dire pour plein de corps de métiers. Au Mali c’est différent, les danseurs sont danseurs avant d’être danseurs hip-hop, on a pu le voir dans des soirées. Les danseurs africains respectent beaucoup les autres danseurs, même s’ils arrivent avec une touche Hip-Hop. Ce sont avant tout des danseurs, on les respecte pour cela. La danse africaine vient aussi de l’échange entre les styles, on s’enrichit du mouvement de l’autre. C’est aussi la base de la danse Hip-Hop. En France, si on veut être le meilleur en break dance, on ne fait que du break dance, si on veut être le meilleur en popping du coup on ne fait que du popping pour être le meilleur… C’est la grande différence…
Vous vous êtes rendus à plusieurs reprises au Mali. Un choc ?
Choc des cultures… On arrive dans un pays qui est moins développé que la France : il y a beaucoup moins de technologie, toutes les routes ne sont pas goudronnées, tout le monde n’a pas l’eau courante ou l’électricité… Forcément ça fait un choc, mais le vrai choc ça a été le contact avec la population. Les Maliens sont plus pauvres que les Français mais ils sont beaucoup plus généreux. Des gens qui n’ont rien, des enfants qui n’ont rien, ils partagent quand même le peu qu’ils ont. Même avec nous français, blancs d’Europe, réputés pour avoir de l’argent puisqu’on a l’euro. Ce n’est pas ce qu’ils ont cherché chez nous, ils ont cherché à discuter à échanger, à parler de comment on vit, de nos familles de nos parents… Ils nous ont ouvert leur porte, ils ont partagé leur repas avec nous sans rien demander en retour. C’était un vrai choc pour nous, en France les gens n’ont pas le contact si facile. Pour parler avec des gens, il faut les connaître ou que quelqu’un nous les présente… alors que là, on se fait interpeller dans la rue pour boire le thé, discuter…
« Dyptik » témoigne d’une quête identitaire. Seriez-vous toujours à la recherche de votre identité ?
Tous les êtres humains sont un peu à la recherche de leur identité. Du premier au dernier jour, la quête de l’identité, c’est la quête de la vie. C’est de savoir qui on est, où on est, dans quel groupe on se situe, à quel endroit du groupe on est et comment on peut évoluer à travers le groupe. C’est une recherche perpétuelle d’identité, pour tous les hommes, de toutes les tribus ou générations, c’est la même chose.
Il y a quelque temps, l’ancien gouvernement avait lancé un débat controversé sur cette question de l’identité française. Comment avez-vous vécu cette remise en question, puisque cela en était une ?
Il y a eu en France beaucoup de vagues d’immigration, de tous les pays : que ce soit d’Europe, du Maghreb, d’Afrique… Ces vagues d’immigration ont enrichi la France, selon nous. Ce n’est peut-être pas du goût de tout le monde puisque certains ont l’impression de perdre leur identité française, de perdre quelque chose. On le voit plutôt comme une nouvelle richesse. La France vue de l’extérieur dans les autres pays du monde, est vue comme un pays où les gens peuvent venir s’installer, échanger, peuvent venir enrichir et s’enrichir culturellement parlant. La culture française est réputée à travers le monde, en peinture, en danse en musique… Quand on parle d’un débat controversé sur la question de l’identité française, justement, l’identité française, elle évolue, elle est multiple. Certains pensent peut-être que c’est un mal. Nous, nous pensons au contraire que c’est un bien.
Comment s’est déroulée la création de « Dyptik » ?
À la base, c’est donc une rencontre avec l’équipe malienne (4 danseurs de la compagnie Dogmen G). On avait déjà l’idée en tête mais la rencontre a fait tilt. Cette rencontre nous a donné envie de parler de l’identité. Avoir une pratique qui est la même mais des origines et vécues différents, a beaucoup influencé l’identité artistique du projet. C’est ce que nous allons montrer à travers ce spectacle. Comment nos vécus, nos rencontres, nos passés nous ont enrichis chacun de notre côté sur une même pratique mais ont créé des identités complètement différentes. Techniquement ça a été un peu plus compliqué qu’une pièce « habituelle », dans le sens où il a fallu gérer la venue d’artistes étrangers ce qui n’est pas toujours simple, notamment avec l’obtention de visa… La création a pris beaucoup de retard puisque le projet est initié depuis 2011. Mais avec les différents coups d’États au Mali, tout a été retardé et nous avons décalé le projet d’un an. La politique a un peu influencé le projet, nous n’avons pas pu gérer les résidences comme nous l’avions prévu au départ, mais dorénavant ça se passe bien. L’échange entre les danseurs fonctionne bien. L’impact a juste été au niveau organisationnel.
Comment les rôles se sont-ils répartis ?
On a identifié un chorégraphe, Souhail Marchiche, qui ne danse pas sur la pièce pour pouvoir avoir du recul sur le travail, une vision globale et objective. Mehdi Meghari a le rôle d’assistant ce qui permet de faire des retours du point de vue des danseurs, sur la gestion des répétitions, la compréhension… Car avec les Maliens parfois, on parle un peu vite ou dans un français un peu modifié en argot, ils ne comprennent pas forcément tout de suite, ils ont besoin souvent qu’on leur montre, qu’on prenne le temps. À l’intérieur du groupe de huit danseurs, il était important que chacun apporte son identité dans le spectacle. Sur les premières résidences, c’était vraiment les danseurs qui étaient force de proposition. On a aussi recruté deux filles sur casting, c’était important qu’il y ait une touche féminine sur ce spectacle. Qui plus est, elles ont une identité très forte. Puis dans un second temps, nous avons pris les choses en main, agencé la matière créée : on la met en ordre pour que ce soit lisible et agréable pour le spectateur tout en gardant le propos de départ.
Parlez-nous de l’environnement scénographique et musical de cette création ?
Nous avons fait appel à un créateur son Patrick De Oliveira, qui vient plutôt de la musique électro. On lui a expliqué le projet de A à Z. L’idée est que chacun puisse faire des propositions, qu’il exprime son identité, qu’il s’approprie le projet. Dans un deuxième temps nous avons les choses, pris le temps de travailler danse et musique en même temps pour former un tout, l’idée est d’imbriquer les deux au mieux. Pour ce spectacle, étant donné qu’il y a déjà huit danseurs, huit identités fortes, huit corps différents, l’idée est d’alléger un maximum la scénographie, d’être le plus épuré possible de vraiment laisser la place à la danse et à l’identité, à la personnalité de chaque danseur.
Cette création s’accompagne également d’un volet de médiation culturelle au Mali. Pouvez-vous nous en parler ?
Nous avons organisé des master class à Bamako pour les jeunes breakers, puisqu’à la base nous sommes perfectionnés break. C’était une belle rencontre, ils étaient très heureux. On a pu leur apprendre plein de choses. Nous sommes aussi allés danser avec des enfants dans un orphelinat, cela a débouché sur un vrai échange : ils nous ont montré des pas de danse africaine et nous de Hip-Hop. On a aussi participé à l’organisation d’un Battle avec les danseurs de la compagnie Dogmen G. Enfin nous avons pu faire deux représentations publiques à Bamako et Siby devant des jeunes danseurs puis échanger avec eux. Ces échanges ont été forts car les Maliens, à la différence des Français, disent les choses comme elles sont, sans arrières pensées. On appelle un blanc un blanc, un noir un noir, un petit un petit, un gros un gros, sans arrières pensées sans juger. De fait, ils sont plutôt directs dans leurs retours et c’est quelque chose de très important. Quand on n’a pas l’habitude au début on peut se sentir choqué, critiqué, mais c’est leur façon d’être en fin de compte.
Qu’attendez-vous de cette création ?
Pour commencer, nous attendons un échange, c’est la base de ce projet entre la France et le Mali. Pas seulement entre les danseurs. On a pu faire de la médiation là-bas, ils vont en faire également ici auprès de nos jeunes ou dans des établissements scolaires. Autour de la création, il y a un vrai projet d’échange entre la France et le Mali. Après, si le spectacle peut tourner un maximum en France et en Afrique, nous mission sera accomplie.
Cette création bénéficie d’un large réseau de coproductions. Est-ce un luxe ou une nécessité en cette période de restriction budgétaire ?
C’est une nécessité mais aussi un luxe, c’est vrai. Une nécessité car nous avons besoin d’un maximum d’assurances de lieux de répétition, de financements puisque nous faisons venir des danseurs de l’autre bout du monde. Il faut pouvoir les accueillir, les rémunérer… Ce qui ne serait tout à fait la même chose si nous avions une équipe française. C’est moins risqué, si le projet ne fonctionne pas, chacun rentre chez soi et retourne à ses occupations alors que là c’était compliqué de faire venir des Maliens et de leur dire « ben finalement vous rentrez chez vous… » C’était aussi important car un de nos objectifs avec la création de la compagnie Dyptik, était de sortir de notre réseau habituel en Rhône-Alpes et de pouvoir montrer notre travail ailleurs. C’est important d’aller faire des résidences et rencontrer des publics ailleurs qu’à Saint-Étienne, de pouvoir échanger et d’avoir des retours.
Vous avez participé à plusieurs reprises à la Biennale de la Danse de Lyon. Qu’avez-vous retiré de ces expériences ?
C’est notre troisième participation au Défilé de la Biennale de la Danse. C’est une approche très différente des ateliers, par le nombre de participants et la variété du public tant au niveau de l’âge que de la pratique. Il faut donc être capable d’adapter son contenu et sa pédagogie pour que tous s’y retrouvent. L’idée est d’amener le groupe au bout de l’expérience sans perdre personne. On doit évoluer sur le travail de pédagogie et de transmission, on peut aussi sentir cette expérience sur notre nouvelle création, entourés de danseurs aux pratiques et expériences différentes.
Comment voyez-vous l’avenir de votre compagnie ?
Le but est de continuer à faire ce qu’on aime, le plus longtemps possible. Continuer dans 10 ans, 20 ans, former de jeunes danseurs pour prendre la relève.
Le Hip-Hop, a-t-il définitivement gagné ses lettres de noblesse au sein du paysage chorégraphique contemporain ?
Le Hip-Hop les a gagné bien avant qu’on arrive, quand on a commencé, il avait déjà investi les théâtres… Grâce notamment à la compagnie Lyonnaise Käfig, de Mourad Merzouki, qui tourne beaucoup, son spectacle « Récital » a eu énormément de succès… Nous avons eu la chance également de profiter des conseils des anciens qui nous ont un peu ouvert les portes aussi. Maintenant, c’est à nous d’aller pousser les plus petites portes et d’étendre le réseau Hip-Hop le plus loin possible.
Alors que le Rap est souvent réduit à sa dimension contestataire, la danse Hip-Hop a acquis, à travers le monde, une reconnaissance plus large. Comment expliquez-vous cette différence ?
Ca dépend de ce qu’on écoute comme rap…C’est un peu comme si on réduit le Hip-Hop est une pratique urbaine de rue ! C’est sûr, si on va voir uniquement des spectacles de rue en Hip-Hop, on peut penser que le Hip-Hop est réduit à une pratique de rue. Si on va voir des gamins s’entraîner dans la rue, oui ! Maintenant si on va voir dans un conservatoire des danseurs Hip-Hop s’entraîner ou sur des scènes nationales, avec des créations Hip-Hop, la reconnaissance sera bien plus large. C’est un peu la même chose avec les rappeurs : Voir un rappeur de quartier qui est en train de contester que le maire ne lui a pas mis à disposition une salle, du coup il est en train de le pourrir… Du coup, on va le trouver contestataire. Mais dans le même temps, d’autres rappeurs cartonnent à l’international et ne sont pas spécialement dans une dimension contestataire. Nous ne sommes pas d’accord avec ça.
Un dernier mot ?
Notre but est de transmettre à un maximum de monde notre passion, notre énergie et notre envie… d’aller au bout de nos idées. On espère qu’on va emmener un maximum de monde dans notre état d’esprit et avec notre énergie.